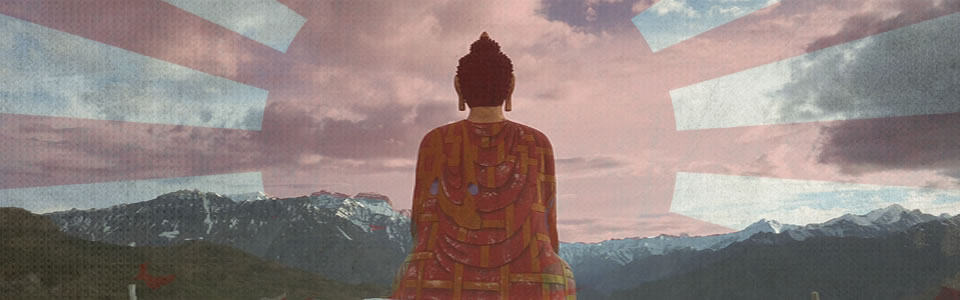Cocaïne, héroïne, cannabis, amphétamines… le chiffre d’affaires des différents marchés helvétiques des stupéfiants est estimé bien au-delà du milliard de francs par an.
Principe de précaution. Quand il va dans les étages de sa belle maison ocre, Michel Graf n’oublie pas son trousseau numérique. Aucune porte ne s’ouvre sans cette clé intelligente. «Trop de visiteurs indésirables», explique-t-il. A mi-pente de l’avenue Ruchonnet à Lausanne, la maison ocre est le siège d’Addiction Suisse, dont Michel Graf est le directeur. Son nom dit tout: la fondation travaille, recherche, informe sur toutes les toxicomanies.
Quand son principal souci était l’alcoolisme, aucun poivrot n’aurait eu l’idée de forcer sa porte, la nuit, pour mettre la main sur une bouteille. Mais maintenant qu’elle s’occupe beaucoup de drogues illégales, Addiction Suisse agit comme un aimant. Des braqueurs ont trop souvent violé la villa dans l’espoir absurde d’y trouver un sachet d’héroïne ou de cocaïne. Ils sont parfois repartis avec des ordinateurs, peut-être pour y trouver des informations utiles à leur consommation. La fondation a dû se barricader.
La maison protégée de l’avenue Ruchonnet est un bon point de départ pour entreprendre un voyage dans le marché des stupéfiants en Suisse. C’est le début d’une métaphore troublante. Ceux qui travaillent dans ces bureaux aérés sont acharnés à faire reculer dans le pays la dépendance aux substances toxiques, légales ou non. Ils le font dans une ville où les policiers sont mobilisés dans des opérations répétitives et démonstratives pour tenter de réduire la trop visible vente de drogue dans la rue.
Et pourtant, sortant de la villa ocre, il vous suffit de marcher 200 mètres vers la gare pour tomber sur un petit groupe de dealers, imperturbables, toujours à la même place près d’un escalier abrité, et dont on a parfois l’impression qu’ils utilisent la couleur de leur peau – ils sont Africains – comme signe de reconnaissance, sans aucun souci apparent d’être importunés.
Vous pouvez aussi prendre Ruchonnet dans l’autre sens, à la montée, et passer le pont Chauderon. Même tableau: au bas de l’avenue de France, au Maupas ou au carrefour de l’avenue d’Echallens, les vendeurs sont en faction, téléphone à l’oreille, répondant par un sourire ou un petit hochement de tête au moindre signe de connivence. Ils sont sans crainte.
Le bureau de Grégoire Junod n’est pourtant qu’à 100 mètres de là. Pour accéder aux services du municipal chargé de la police, il faut demander l’ouverture de la porte par un téléphone réservé à cet usage. «Trop de visiteurs indésirables», dit la secrétaire. Principe de précaution.
L’affable jeune élu socialiste a hérité l’an passé, dans un remaniement très politique, d’un drôle de dicastère doublement brûlant: le logement et la sécurité. Le fardeau, côté police: mauvaise note en matière de criminalité et omniprésence du trafic de drogue.
Pour faire reculer les dealers, Lausanne a lancé récemment deux opérations, l’une avec ses moyens propres, ambitieusement baptisée Héraclès, l’autre avec l’appui policier du canton, Strada. Grégoire Junod dit qu’il est trop tôt pour tirer le bilan de ces actions, mais le résultat, pour le promeneur curieux, n’est pas éclatant.
Cet activisme a valu à Lausanne une réputation sulfureuse dans les milieux qui s’occupent de toxicomanie, allergiques désormais à la répression comme réponse prioritaire au fléau.
Le psychiatre Toni Berthel, qui préside la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, ne veut pas jeter d’anathème, mais il constate que les grandes villes suisses alémaniques ont mieux su gérer la nuisance trop manifeste du marché illégal par une bonne interaction entre la police et les services sociaux.
Bâle et Zurich, par exemple, revendiquent la liberté de développer des expériences qui ont commencé par l’ouverture de locaux d’injection et peuvent aller jusqu’à la quasi-dépénalisation du cannabis, afin de sortir du cul-de-sac répressif.
Y a-t-il un Drogengraben entre les deux parties du pays? Ruth Dreifuss, qui fut notre ministre de première ligne quand il fallut faire face aux scènes ouvertes à Berne et à Zurich sous les caméras effarées du monde entier, soupçonne que chaque aire linguistique subit l’influence de son voisin: la France, en matière de toxicomanie, est impitoyable, l’Allemagne est bien plus souple.
La politique des quatre piliers
Grégoire Junod, en tout cas, ne veut pas entrer dans l’habit de Père Fouettard qu’on lui tend. Il ne croit d’ailleurs pas que la police soit en mesure d’endiguer le marché des drogues. «Mais ce que nous ne pouvons pas tolérer, c’est l’accaparement de l’espace public par les dealers. Les rues et les places appartiennent aux habitants de cette ville, pas à ce commerce illégal, qui génère parfois de la violence. Et puis, nous appliquons la loi telle qu’elle est tant qu’on ne l’a pas modifiée.»
Il y a six ans, seule parmi les grandes villes suisses, Lausanne avait rejeté par référendum l’ouverture d’un local d’injection, et le municipal doit aussi gérer les passions polarisées qui persistent dans sa cité autour de la toxicomanie. «Cela ne nous empêche pas de consacrer des millions à l’accueil et à la prise en charge des toxicomanes dépendants, pour limiter les risques de la consommation. La politique des quatre piliers de la Confédération est bien sûr aussi la nôtre.»
Les quatre piliers, c’est un peu l’héritage de Ruth Dreifuss, ce qui était resté de ses réformes après le refus par les Chambres, en 2004, de tolérer, sous strictes conditions, la production, la vente et la consommation du cannabis, comme elle l’avait proposé.
Dans cette politique approuvée par le peuple en 2008, il y a trois piliers doux: la prévention pour freiner la consommation, la thérapie pour sortir de la dépendance ou aider à vivre avec, la réduction des risques pour écarter le pire du mal (seringues propres, locaux d’injection, etc.). Le quatrième pilier, c’est le dur: la répression.
Mais cette présentation de la loi crée l’illusion d’un équilibre. En fait, le gros bâton absorbe les deux tiers des crédits que la Confédération alloue à sa politique en matière de stupéfiants. Et pour les interpellations de consommateurs de drogues, la Suisse est parmi les pays les plus actifs.
Nussbaumstrasse, pas loin du Wankdorf à Berne: le gros bâton est là. Pour entrer dans le cœur sensible de ce bâtiment neuf et rouge qui abrite la police fédérale, il faut se faufiler dans un sas cylindrique. Une première porte se ferme derrière vous. L’autre s’ouvrira, devant, si votre hôte appuie sur le bon bouton. Pas de visiteurs indésirables. Principe de précaution.
La porte s’est ouverte. Christian Schneider est l’analyste, pour FedPol, du marché des drogues. Cet homme jeune aux cheveux très courts, qui semble tout juste sorti de l’adolescence, est emblématique de la manière dont la Suisse traite son problème de stupéfiants: plutôt dure dans les textes, plutôt souple dans la pratique.
Avant d’entrer au service de la police, Schneider a soutenu à l’Université de Zurich une thèse au bazooka sur l’UNODC, l’office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il y fait le procès de cette agence qui a constamment, sous la pression essentielle des Etats-Unis, imposé de Vienne aux 183 Etats membres une politique presque uniquement répressive.
A ceux qui doutent de l’efficacité de la «guerre contre la drogue» menée depuis quarante ans, l’agence onusienne oppose les conventions signées. Cette intransigeance est peut-être en train d’évoluer, en particulier sous les coups de boutoir d’Etats latino-américains qui, n’en pouvant plus de cette guerre meurtrière, veulent expérimenter d’autres voies.
La controverse sera au menu d’une conférence mondiale annoncée pour 2016. La Suisse est signataire des conventions répressives, mais la thèse de l’expert ès drogues à FedPol montre qu’à Berne ceux qui sont chargés de manier le bâton sont aussi gagnés par le doute.
Si Christian Schneider a quelques certitudes théoriques, dans la pratique du terrain, c’est une autre paire de manches. «Il y a beaucoup de known unknows dans le marché des stupéfiants, dit-il en paraphrasant Donald Rumsfeld, l’ancien patron du Pentagone. Beaucoup de choses dont nous savons que nous les ignorons.» Parole d’expert!
Et commerce extraordinaire dans ce pays – la drogue prohibée est le seul bien qu’on peut acheter à toute heure du jour ou de la nuit, et un peu partout – «la cocaïne, dit Schneider, a maintenant pénétré les campagnes comme les villes». Il suffit de connaître un vendeur, et il faudrait être aveugle pour ne pas le trouver.
Malgré cette grande et très publique disponibilité, l’illégalité rend le marché des drogues parfaitement opaque. Comment savoir ce qui s’importe, se vend et se consomme en Suisse? Les chiffres qu’on découvre en enquêtant donnent le vertige en raison de leur imprécision et de leur versatilité en fonction des interlocuteurs.
Les saisies que pratiquent la douane, la poste et la police donnent d’abord une mesure, au gramme près, de l’efficacité de ces services publics. Mais quelle part des stupéfiants interdits échappe au flair des fonctionnaires? Le flou commence là: entre 85 et 95%, dit-on en Suisse; l’ONU est légèrement plus optimiste.
L’Office fédéral de la santé publique, pour tenter de cerner un peu mieux la consommation indigène de stup, finance depuis deux ans une opération nationale de monitorage. C’est une enquête, à laquelle participe Addiction Suisse, menée chaque année par téléphone auprès de 11 000 personnes résidant dans le pays.
Les sondeurs, en présentant leurs résultats, recommandent de les manier avec prudence. On les comprend. Prenez-vous de l’héroïne? Souvent? Vous fumez ou vous vous piquez? La garantie d’obtenir des réponses parfaitement honnêtes à de telles questions n’est forcément pas très grande.
La connaissance de la toxicomanie a récemment reçu un renfort plus scientifique, mais assez nauséabond. Ce que les citadins ingèrent et expulsent finit dans les stations d’épuration. Or la technologie biochimique permet aujourd’hui de mesurer très précisément ce que contiennent les eaux usées, et en particulier les substances exotiques, opiacés, ecstasy, cocaïne ou autres.
Des prélèvements réalisés dans toute l’Europe ont ainsi permis d’établir un classement des villes en fonction de leur consommation de coke. Les cités suisses tiennent bien leur rang – Genève, Lucerne – dans le peloton de tête: 0,8 (la semaine) à 2,8 grammes (le week-end) de cocaïne pour 1000 habitants.
Zurich est franchement shooté à l’occasion de la Street Parade (4,7 grammes), et Saint-Moritz pour le Nouvel-An: comme pour confirmer que la poudre blanche est encore une drogue de riche, ce qui n’est plus vraiment le cas.
Que donne ce faisceau de données approximatives? Commençons par la cocaïne puisqu’elle est assez en vogue, bien que sa consommation semble depuis peu se stabiliser. Ce qui atterrit sur la table des sniffeurs suisses se situe quelque part entre 3,7 et 5,3 tonnes par an. Pardon pour la marge d’erreur!
Autour de la table, il y a à peu près 240 000 convives, l’effectif de ceux qui admettent avoir une fois ou l’autre touché à la coke. Le nombre des consommateurs plus réguliers est d’environ 16 000. Le prix du gramme de cocaïne est assez élastique, mais en moyenne il tourne autour de 90 à 100 francs.
Le pactole des trafiquants n’est pas loin du demi-milliard de francs. Fourchette en général retenue: entre 370 et 530 millions. L’estimation d’Olivier Guéniat est plus cossue: 810 millions. Encore un universitaire qui a choisi l’uniforme: Guéniat est commandant de la police du Jura après avoir exercé les mêmes fonctions à Neuchâtel.
Sa connaissance de la drogue va de la faculté au terrain en passant par le labo. Il a croisé un jour un dealer qui mangeait sans problème un sandwich avec une douzaine de boulettes de cocaïne dans la bouche.
La coke de rue ne se vend pas au gramme, mais en boulettes. Un gramme donne cinq à huit boulettes, facilement cachées derrière les dents, ou ailleurs: l’anus, souvent. Un gramme de drogue? Pas vraiment. La poudre est mélangée à des produits de coupage dans une proportion que le consommateur ne connaît pas.
Multiplication des boulettes coupées, démultiplication des profits. A Delémont, le commandant a calculé qu’un vendeur de rue, avec un kilo de cocaïne, peut se faire 200 000 à 300 000 francs. A ce taux-là, on peut prendre quelques risques.
Comment se fait-il que la vente de rue, en Suisse, soit presque entièrement aux mains de jeunes Africains de la côte atlantique? Naguère, le marché de la cocaïne était tenu ici par des gangs dominicains, et peut-être un peu par la Ndrangheta calabraise, dont FedPol semble avoir du mal à percer les méandres locaux.
Le produit venait d’Amérique latine directement en Europe, mais les saisies qu’ont subies les trafiquants les ont incités à emprunter le détour africain en passant le plus souvent par le Nigeria. Aujourd’hui, la drogue arrive principalement par bateau, dans les ports ibériques ou néerlandais.
«Certaines parties du port de Rotterdam, dit Pierre Esseiva, professeur de police scientifique à l’Université de Lausanne, sont si bien tenues par les gangs que les forces de l’ordre ne s’y aventurent pas trop.» De là, la distribution se fait par la route, le rail ou les airs.
Mais toute tentative de description du trafic est téméraire, tant cette circulation de marchandise est souple et sans cesse adaptée en fonction des écueils policiers qu’elle rencontre. De la même manière, Christian Schneider ne parvient pas à dire comment sont recrutés les dealers de rue. En Afrique, et envoyés à dessein en Europe? En Suisse même? L’analyste penche pour la seconde hypothèse. Mais qui recrute, alors? Le mystère s’épaissit encore.
Cette fluidité du trafic illégal a amené l’ouverture d’une nouvelle route, par l’Afrique aussi, pour l’héroïne. Ce détour a sans doute été provoqué par un activisme nouveau de la police turque contre la traditionnelle filière des Balkans. Une troisième voie alimente l’Europe, par le nord, pour satisfaire le juteux marché russe et des anciennes démocraties populaires.
L’ouverture de la route du sud, de l’Afghanistan par le Pakistan, l’Iran et la mer jusqu’en Afrique orientale, explique sans doute l’apparition de revendeurs maghrébins dans les rues suisses. Mais ils sont minoritaires. Le marché, ici, est toujours tenu par des clans albanais de différentes nationalités, et par quelques Serbes en Suisse allemande.
L’héroïne reparaît
On a pu croire récemment que l’héroïne et ses cousines opiacées étaient en voie de paupérisation en Suisse. Il y a eu, à partir de 2009, une forte pénurie sur le marché local. On disait même, sombrement: la population des junkies à la seringue vieillit et meurt… Puis des signes de reprise sont apparus. A cause de la route du sud?
«En matière de drogue, dit Christian Schneider, c’est la demande qui crée le marché, pas l’inverse. Et pour tenter de comprendre l’évolution de la demande, il faut prendre en compte un grand nombre de facteurs: sociologique, psychologique, épidémiologique, le rôle de la prévention, et le comportement des trafiquants, quand même…» Le monitorage, pour l’héroïne, fait apparaître que 8000 Suisses ou résidents sont des consommateurs accrochés, et que 64 000 ont touché à la poudre.
D’un autre côté, 18 000 ex sont inscrits dans des programmes de substitution à la méthadone, et 1300 autres dans des programmes de prescription d’héroïne, ce qui, évalue-t-on, représente un manque à gagner de près d’une tonne de came pour les trafiquants. Reste quand même un marché très profitable de 1,8 à 2,6 tonnes par an. Au pif: 150 millions de francs, sans tenir compte du coupage, ce qui pourrait mener bien plus loin…
On aurait peut-être dû commencer par le populaire cannabis. Mais allons du dur au doux, et du dehors africain au dedans helvétique. Le haschisch (la résine de cannabis) vient pour l’essentiel du Maroc, avec la bénédiction du commandeur des croyants, mais ce n’est qu’une petite partie de la consommation suisse de cannabis. Pour le reste, le chanvre, c’est d’abord une affaire et une histoire nationales. La Suisse, à certains moments, est exportatrice nette de marijuana.
Une industrie – si le taux de THC (tétrahydrocannabinol pour les intimes) est trop élevé – encore illégale, modérément. Le cannabis viole toujours le code, mais, dès cet automne, le consommateur ne risquera plus qu’une amende de 100 francs s’il est attrapé. Naturellement, si chacun prenait un ticket, ça ferait une belle somme: 2 240 000 Suisses admettent avoir goûté à l’herbe; plus de 400 000 dans l’année écoulée; 220 000 rien que le mois dernier, des hommes et des Romands en majorité.
Ce laxisme apparent est une illusion. Les policiers n’ont pas baissé les bras: 60% des dénonciations pour violation de la loi sur les stupéfiants concernent le cannabis.
A la fin du siècle dernier et, disons, dans la foulée de 68, une assez grande tolérance s’était pourtant installée en Suisse autour du joint. Le chanvre à haute teneur en THC poussait à l’air libre, des boutiques ne cachaient pas trop, ou même plus du tout, leur marchandise.
Bienne, en particulier, s’était fait une réputation commerciale planante. C’est dans ce climat que Ruth Dreifuss a pensé qu’elle pourrait faire passer sa proposition de décriminalisation au parlement. Ce fut non, et dans la foulée le peuple rejeta sèchement, en 2008, une initiative populaire dans le même sens.
Retour de gros bâton. Les champs furent fauchés et les punitions se remirent à pleuvoir. Sans grand effet sur la consommation, ni vraiment sur la production. La culture s’est réfugiée dans les maisons, sous des serres, dans des caves.
De temps en temps, la police fait une razzia, et il y a procès quand les plants sont décidément trop nombreux: plus de 7000, par exemple, il y a moins d’un an dans le Val-de-Travers. Mais le pays produit encore la plus grande partie de sa came verte. La plus grande partie de combien?
Entre vingt et quarante tonnes par an, dit FedPol, reconnaissant que son estimation est hasardeuse, tant la culture et la consommation du cannabis sont devenues privées et dissimulées. Guéniat avance le chiffre de 130 tonnes.
Entre amis, le prix du gramme de marijuana tel qu’il est pratiqué dans la rue (12 francs en moyenne) n’a pas de sens, et le chiffre d’affaires de la branche cannabis est difficile à établir: sans doute un demi-milliard de francs, plus ou moins.
Trois drogues, et on n’a encore rien dit. La liste est longue: amphétamines et méthamphétamine (12 kg saisis l’an passé), LSD (3000 doses), khat (1,5 tonne), ecstasy (24 000 doses), champignons hallucinogènes (30 kg)… Ce n’est qu’un début.
Afflux de nouvelles substances
L’ONU a inscrit 234 produits sur sa liste des substances interdites, mais rien que l’an passé elle en a recensé 251 autres, inconnus jusque-là au bataillon, et chaque semaine un nouveau nom au moins est ajouté à cette nomenclature stupéfiante. Cet affolement a un sigle: NPS. Nouveaux produits de synthèse, ou nouvelles substances psychoactives, comme préfèrent dire les Américains. Coup sur coup, l’agence des Nations Unies et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies viennent de mettre en garde les Etats contre cette déferlante.
Scénario simple: des chimistes de l’ombre produisent dans leurs labos cachés des substances dont les effets sont comparables à ceux des drogues répertoriées, mais qui ne violent pas les lois puisqu’elles sont inconnues, ou pas encore prohibées. La loi finit bien sûr par s’en mêler, mais avec retard, et quand l’interdit tombe, les chimistes ont déjà mis en circulation d’autres molécules.
En Suisse, assure Christian Schneider, il faut six mois pour qu’une nouvelle drogue soit inscrite sur la liste de prohibition. En France et en Allemagne, ajoute-t-il, la procédure prend des années.
Selon les brigades cantonales de stup, FedPol ou le Drug Testing zurichois – ce service dans lequel les consommateurs peuvent faire vérifier la pureté de leur produit – les NPS ne sont encore dans le pays qu’un marché de niche. Mais il est très mal connu et, pense Schneider, il est là pour durer.
La production des NPS ne dépend plus de cueilleurs de coca ou de cultivateurs de pavot dans de hautes vallées perdues ni de trafics au long cours à hauts risques et de vendeurs de rue.
La série américaine
Breaking Bad, une fiction bien sûr, décrit bien cette nouvelle réalité: Walt White, le producteur en masse de cristaux magiques, est un prof de chimie qui ne parvient pas, avec son salaire et son assurance, à soigner son cancer; les ingrédients dont il a besoin, il va les chercher au mall du coin et il en remplit son caddie. La vente, ensuite, se fait dans les rues d’Albuquerque; mais là, la TV a un train de retard.
En réalité, le réseau de distribution des NPS, c’est internet et la poste. Il y a peu, un douanier suisse a ouvert, au hasard, un paquet venant de Chine. Lotion capillaire, disait l’emballage. L’analyse du produit a révélé qu’il s’agissait de méthylone, substance récente aux effets comparables à ceux de l’ecstasy. Taper «méthylone» sur Google: vous aurez près de 6000 réponses, et d’innombrables conseils sur l’achat, la manière de consommer, les plaisirs résultants, les mauvais trips…
Au début de l’an passé, on dénombrait sur la toile 693 sites de vente de NPS. Le plus connu mondialement est l’américain Silk Road, «l’amazon.com de la drogue», que le FBI vient de saisir.
Les achats s’y faisaient sans laisser de traces dans le «web profond», par l’intermédiaire du moteur de recherche Tor dont il n’est pas difficile de trouver la clé, et les transactions se réglaient en bitcoins, monnaie virtuelle.
Le douanier qui a intercepté l’envoi de méthylone n’avait pas agi tout à fait au hasard: l’expéditeur chinois lui disait quelque chose. La Chine est le principal fournisseur de NPS, sous la forme de produits prêts à être consommés ou de précurseurs (l’éthylène par exemple) qui partent par baril vers des laboratoires discrets, en Europe ou ailleurs.
Marché affolant, donc, mais ampleur encore inconnue. Même constat que pour les autres substances: établir le chiffre d’affaires des différents marchés helvétiques des stupéfiants semble de plus en plus difficile au fur et à mesure que l’enquête avance.
Mais si on ajoute, au demi-milliard ou aux centaines de millions des drogues les plus courantes, les revenus de la ribambelle de substances qui s’allongent jusqu’aux NPS, on obtient un chiffre dodu: à coup sûr bien au-delà du milliard de francs par année. C’est ce qu’empochent les mafias et leurs petites mains.
Mais le prix à payer pour les drogues ne se limite pas à ce que dépensent les consommateurs. La défonce a un coût social que l’Office fédéral de la santé publique a voulu connaître en confiant un mandat à l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel. Les chiffres datent du début du siècle et ce sont les derniers disponibles. Le professeur Claude Jeanrenaud, qui a dirigé l’enquête, remarque qu’il aurait pu tenir compte aussi des coûts imposés aux pays d’où vient et par où transite la drogue: morts, corruption, etc.
Mais l’addition, à l’intérieur des frontières helvétiques, est déjà salée. Elle apparaît en trois colonnes. Le prix de la prise en charge et du traitement des toxicomanes, ajouté à celui de la répression, s’élevait pour 2000 à 1,4 milliard de francs. Les coûts indirects (pertes de production dues à la surmortalité, à l’incapacité de travailler ou à la participation au trafic) sont évalués à 2,3 milliards.
L’étude ajoute 400 millions pour tenir compte des dépenses que consentent les familles dans l’assistance, parmi elles, aux personnes dépendantes. Coût total, au moment de l’enquête: 4,1 milliards.
Si on ajoute à cette facture sociale le chiffre d’affaires sommairement évalué pour toutes les substances illégales vendues en Suisse, il faut situer le prix de la drogue quelque part entre 5 et 10 milliards de francs par an. Les mafias disent merci.
La prohibition est un échec
Alors, on continue comme ça? Une course-poursuite sans fin du gendarme et du dealer pendant que le marché illégal s’adapte, se diversifie et s’installe sur internet? L’enquête dans tous les milieux qui ont affaire aux stupéfiants fait apparaître une réponse largement partagée: la prohibition est un échec, elle crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Mais les professionnels sont très minoritaires. Dans l’autre camp, favorable au maintien des drogues dans l’illégalité, il y a une majorité de la population – les votes du peuple et du parlement l’ont montré. Et, bien sûr, les dealers. Et aussi des policiers, qui ont pourtant leurs doutes. L’un d’eux, à Lausanne, parle de son travail avec humour et résignation.
Faisant usage du droit qu’ont les agents des stups de se faire passer pour des consommateurs quand ils veulent prendre un vendeur en flagrant délit, il est sorti l’autre jour de l’hôtel de police pour une patrouille; moins d’une minute plus tard, il avait une boulette à 40 francs. Succès dérisoire et éphémère.
«Ce n’est pas ainsi qu’on vaincra le trafic, dit-il. Il faut frapper au seul endroit sensible: la caisse. Nous avons obtenu des résultats contre les réseaux albanais de l’héroïne, en contraignant les autorités, sur place, à saisir des biens acquis avec l’argent de la drogue.» Envoyer des émissaires à Lagos, pour convaincre le gouvernement nigérian d’agir contre l’argent sale? Bon voyage!
Ruth Dreifuss, elle aussi, dit qu’il faut agir contre le blanchiment, et qu’on ne le fait pas encore assez ici, en Suisse. Mais l’ancienne conseillère fédérale est surtout engagée, aujourd’hui, dans la Commission mondiale pour la politique des drogues, qui rassemble des hommes et femmes d’Etat convaincus, par leur propre expérience, de la nécessité d’une grande révision.
Les travaux de ces commissaires globaux ne sont pas sans effet. L’Europe se penche sur les expériences en cours aux Pays-Bas et au Portugal. La légalisation hollandaise a encouragé un peu le tourisme toxicomaniaque. Mais la décriminalisation de toutes les drogues par Lisbonne n’a pas abouti à une augmentation de la consommation, et une réglementation sévère du marché se met en place.
Surtout, aux Etats-Unis, métropole de la guerre contre la drogue, les esprits évoluent vite. Une vingtaine d’Etats ont déjà adouci leurs lois de prohibition du cannabis, et deux autres, le Colorado et Washington, dans l’ouest, ont purement légalisé l’herbe, avec des garde-fous. Et l’administration Obama vient d’annoncer qu’elle ne cherchera pas à faire prévaloir la loi fédérale, plus répressive.
La digue qui a sauté dans les deux Etats les plus permissifs a déjà éveillé l’appétit d’hommes d’affaires qui font des plans pour ce nouveau marché légal qui s’entrouvre, et en tirer profit. Certains ont déjà l’idée d’une chaîne de distribution à l’image de Starbucks…
La Suisse, qui a dit déjà deux fois non à la dépénalisation du cannabis, semblait mal préparée à rouvrir ce débat quand Olivier Guéniat, au début de l’année, a mis son autorité de policier dans la balance pour demander qu’on cesse de poursuivre la production et la consommation privée de marijuana.
Pour faire bon poids, le commandant de la police jurassienne propose aussi qu’on médicalise les autres drogues, en développant les formules de prescription qui ont déjà été expérimentées.
Jean-Félix Savary ne dit pas autre chose: «Notre premier souci devrait être la protection de la santé des consommateurs. Pas la répression. En même temps, bien sûr, il faut tout faire pour réduire la visibilité des drogues et la facilité à s’en procurer.» Savary est le secrétaire général du Groupement romand d’études des addictions, qui rassemble tous les intervenants du secteur.
Son propos radical donne la mesure du ras-le-bol des professionnels contre le discours moralisateur autour de la toxicomanie («la drogue, c’est le mal!») et contre l’immobilisme répressif. «Il n’y a pas de société sans drogue. Ce marché existe, et nous avons le choix: l’abandonner au crime ou essayer d’en prendre le contrôle, de le canaliser en posant des règles et un cadre vérifiable.»
La prohibition, ajoute-t-il, attire vers ce marché noir si profitable toutes sortes d’exclus; il y a une corrélation claire entre drogue et pauvreté. «La police n’est pas la bonne réponse, en tout cas pas la seule. Plus elle tape, plus la concurrence s’excite entre groupes mafieux qui se battent pour les places et finissent par s’armer. Voyez Marseille!»
Des vérités dérangeantes
Ce discours est à vrai dire assez largement répandu s’agissant du chanvre. «J’entends bien Olivier Guéniat et les autres quand ils parlent du cannabis, remarque Grégoire Junod. Mais dès qu’il s’agit de l’héroïne, de la cocaïne et du reste, ce qu’ils disent est nettement plus flou.»
Et en effet, à part ce qui a déjà été tenté (réduction des risques, prescriptions aux dépendants, etc.), ceux qui prônent le contrôle du marché toxique n’ont pas de solutions clés en main, sauf à conseiller de s’inspirer des réglementations en place pour le tabac, l’alcool et les médicaments, qui ne sont pas, pour ces produits familiers, des modèles de réussite. Voyez la vogue du binge drinking.
Retour à la villa ocre d’Addiction Suisse, retour aux vérités dérangeantes du terrain. Michel Graf, lui aussi, constate l’échec de la politique de prohibition. Mais il demande que les peurs de la société face à la drogue soient entendues.
«Il faut tout dire sur la toxicomanie, ce symptôme social: les effets, les risques et les plaisirs. Et bien sûr qu’il faut inventer une politique plus intelligente que le seul interdit, et un contrôle de toutes les drogues. Sur le papier, c’est le meilleur modèle. Mais pour convaincre la population que cette révolution est possible, il faut répondre à toutes les questions les plus simples et les plus difficiles. Sur ce marché contrôlé, qui vendra, et à qui? Qui vérifiera? Qui paiera?»
arracher aux gangs»
L’ancienne conseillère fédérale et membre de la Commission mondiale pour la politique des drogues, prône plus de tolérance.
La guerre contre la drogue est-elle perdue?
Elle a fait beaucoup trop de morts, et pour quel résultat? Les saisies que les polices annoncent triomphalement ne diminuent pas les quantités sur le marché et n’ont pas d’influence sur les prix. Il y a dans l’économie mondiale trois marchés dominants: le pétrole, les armes et la drogue. Le dernier est clandestin, abandonné à des organisations criminelles.
Or ce trafic est le seul pour lequel on peut imaginer d’autres solutions que la seule répression, ce qui serait inimaginable pour d’autres trafics, celui des humains, par exemple. La drogue est un marché qu’on peut arracher aux gangs.
Par quels moyens?
Pour chaque substance, il convient d’expérimenter et d’analyser le type de régulation et de contrôle qui devrait s’appliquer. Prenons le cannabis. Sa consommation, désormais, est largement répandue.
C’est un produit moins addictif que le tabac. J’avais proposé que sa production, sa vente et sa consommation, sous des conditions strictes, ne soient plus traitées comme des crimes. Dans les pays où cette expérience a été tentée avec prudence, il n’y a pas eu d’explosion de consommation.
Peut-on faire de même avec la cocaïne, l’héroïne?
Le modèle du cannabis n’est pas applicable sans autre à tous les produits. Pour l’héroïne, nous avons tenté une forme limitée de régulation pour la population des consommateurs dépendants, en leur proposant une prise en charge, des produits de substitution, ou en prescrivant le produit lié à leur dépendance quand il le fallait, pour les sortir de la marge et du crime.
Je ne suis pas contre tout interdit et contre toute répression. Il y a des limites à imposer: vente aux mineurs, lieux de non-consommation, obligations d’enregistrement, etc. Les réglementations, même imparfaites, qui gèrent les marchés du tabac, de l’alcool ou des médicaments, présentent des modèles dont on peut s’inspirer.
Il faut tout faire pour sortir des impasses mortifères où nous enferme la seule prohibition. Mon souci a toujours été de comprendre où sont les risques pour la santé publique. Et mon expérience m’a convaincue que la prévention, en matière de drogues, est impraticable si la priorité est donnée à la répression.
La prohibition enfonce les consommateurs dans leur dépendance et dans le silence: c’est en fait les livrer aux dealers.
Source : http://www.bilan.ch