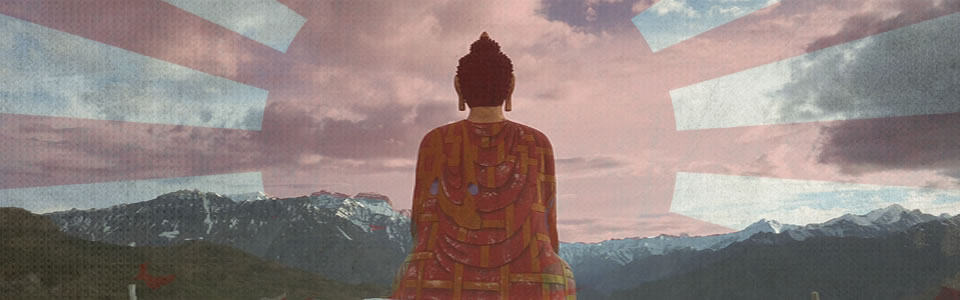Maxime Chaix :
Dans votre dernier ouvrage, La Machine de guerre américaine, vous étudiez en profondeur ce que vous appelez la « connexion narcotique globale ». Pourriez-vous nous éclairer sur cette notion ?
Peter Dale Scott : Avant tout, permettez-moi de définir ce que j’entends par « connexion narcotique ». Les drogues n’entrent pas comme par enchantement aux États-Unis. Parfois, de très importantes cargaisons de drogues sont acheminées dans ce pays avec l’assentiment et/ou la complicité directe de la CIA. Je vais vous l’illustrer par un exemple tiré de
La Machine de guerre américaine. Dans ce livre, je parle du général Ramon Guillén Davila, le directeur d’une unité anti-drogue créée par la CIA au Venezuela, qui fut inculpé à Miami pour avoir introduit clandestinement aux États-Unis une tonne de cocaïne. Selon le
New York Times, « la CIA, malgré les objections de la Drug Enforcement Administration [DEA], approuva la livraison d’au moins une tonne de cocaïne pure à l’aéroport international de Miami [,] comme moyen d’obtenir des renseignements sur les cartels de la drogue colombiens ». Au total, selon le
Wall Street Journal, le général Guillén aurait pu avoir acheminé illégalement plus de 22 tonnes de drogues aux États-Unis. Néanmoins, les autorités US n’ont jamais demandé au Venezuela l’extradition de Guillén pour le juger. De plus, lorsqu’en 2007 il fut arrêté dans son pays pour avoir planifié l’assassinat d’Hugo Chávez, son acte d’accusation était encore maintenu sous scellés à Miami. Ce n’est pas surprenant, sachant qu’il était un allié de la CIA.
Toutefois, la connexion narcotique de l’Agence ne se limite pas aux États-Unis et au Venezuela. Depuis l’après-guerre, elle s’est progressivement étendue à travers le globe. En effet, les États-Unis ont voulu exercer leur influence dans certaines parties du monde mais, en tant que démocratie, ils ne pouvaient pas envoyer l’US Army dans ces régions. Par conséquent, ils ont développé des armées de soutien (
proxy armies) financées par les trafiquants de drogues locaux. Progressivement, ce mode opératoire est devenu une règle générale. C’est l’un des principaux sujets de mon livre,
La Machine de guerre américaine. J’y étudie notamment l’opération
Paper, qui débuta en 1950 avec l’utilisation par l’Agence de l’armée du KMT en Birmanie, qui organisait le trafic de drogues dans la région. Quand il s’est avéré que cette armée était totalement inefficace, la CIA développa sa propre force en Thaïlande (la PARU). L’officier de l’Agence qui en avait la responsabilité a admis qu’elle finançait ses opérations par de très importantes saisies de drogues.
En rétablissant le trafic de drogues en Asie du Sud-Est, le KMT en tant qu’armée de soutien constituait un précédent de ce qui allait devenir une habitude de la CIA : collaborer secrètement avec des groupes financés par les drogues pour mener la guerre — en Indochine et en mer de Chine méridionale dans les années 1950, 60 et 70 ; en Afghanistan et en Amérique centrale dans les années 1980 ; en Colombie dans les années 1990 ; et de nouveau en Afghanistan en 2001 —. Les mêmes secteurs de la CIA en sont responsables, soit les équipes chargées d’organiser les opérations clandestines. Depuis l’après-guerre, nous pouvons observer comment leurs agents, financés par les bénéfices narcotiques de ces opérations, se déplacent de continents en continents pour répéter le même schéma. C’est pourquoi nous pouvons parler d’une « connexion narcotique globale ».
Maxime Chaix :
D’ailleurs, dans La Machine de guerre américaine, vous remarquez que la production de drogues explose souvent là où les États-Unis interviennent avec leur armée et/ou leurs services de renseignement, et que cette production décline lorsque ces interventions s’achèvent. En Afghanistan, alors que l’OTAN retire progressivement ses troupes, pensez-vous que la production de drogue va diminuer une fois le retrait achevé ?
Peter Dale Scott : Dans le cas de l’Afghanistan, il est intéressant de constater qu’au cours des années 1970, à mesure que le trafic de drogues déclinait en Asie du Sud-Est, la zone frontalière pakistano-afghane devenait peu à peu centrale dans le trafic international d’opium. Finalement, en 1980, la CIA s’impliqua de manière indirecte, mais massive, contre l’URSS dans la guerre d’Afghanistan. D’ailleurs, Zbigniew Brzezinski se vanta auprès du président Carter d’avoir donné aux soviétiques « leur Vietnam ». Toutefois, il déclencha également une épidémie d’héroïne aux États-Unis. En effet, avant 1979, de très faibles quantités d’opium du Croissant d’Or entraient dans ce pays. Or, en une année seulement, 60 % de l’héroïne pénétrant aux États-Unis provenait de cette zone, selon les statistiques officielles.
Comme je le rappelle dans
La Machine de guerre américaine, les coûts sociaux de cette guerre alimentée par la drogue continuent de nous affecter. Par exemple, il y aurait aujourd’hui 5 millions d’héroïnomanes au seul Pakistan. Et pourtant, en 2001, les États-Unis, avec l’aide des trafiquants, relancèrent leurs tentatives d’imposer un processus d’édification nationale à un quasi-État, comptant au moins une douzaine de groupes ethniques majeurs parlant des langues différentes. À cette époque, l’intention qu’avaient les États-Unis d’utiliser des trafiquants de drogue pour se positionner sur le terrain en Afghanistan n’avait pas la moindre ambiguïté. En 2001, la CIA créa sa propre coalition pour lutter contre les talibans en recrutant — et même en important — des trafiquants de drogues, qui étaient en principe d’anciens alliés des années 1980. Comme au Laos en 1959 et en Afghanistan en 1980, l’intervention états-unienne a été une aubaine pour les cartels internationaux des drogues. Avec l’amplification du chaos dans les zones rurales afghanes et l’augmentation du trafic aérien, la production d’opium fit plus que doubler, passant de 3 276 tonnes en 2000 (mais surtout de 185 tonnes en 2001, l’année où les talibans l’interdirent) à 8 200 tonnes en 2007.
Aujourd’hui, il est impossible de déterminer comment va évoluer la production de drogues en Afghanistan. Cependant, si les États-Unis et l’OTAN se contentent de se retirer en laissant le chaos derrière eux, tout le monde en pâtira — sauf les trafiquants de drogues, qui profiteraient du désordre pour leurs activités illicites —. Il serait donc indispensable d’établir une collaboration entre l’Afghanistan et tous les pays avoisinants, incluant la Chine et la Russie (qui peut être considérée comme une nation voisine du fait de ses frontières avec les États d’Asie centrale). Le Conseil international sur la sécurité et le développement (ICOS) a suggéré d’acheter et de transformer l’opium afghan afin de l’utiliser médicalement dans les pays du Tiers-Monde, qui en ont cruellement besoin. Washington reste opposé à cette mesure, qui est difficile à mettre en œuvre en l’absence d’un système de maintien de l’ordre efficace et solide. Dans tous les cas, nous devons aller vers une solution multilatérale incluant l’Iran, une nation très affectée par le trafic de drogues venant d’Afghanistan. Il est également le pays le plus actif dans la lutte contre les exportations de stupéfiants afghans, et celui qui subit le plus de pertes humaines à cause de ce trafic. Par conséquent, l’Iran devrait être reconnu comme un allié central dans la lutte contre ce fléau mais, pour de nombreuses raisons, ce pays est considéré comme un ennemi dans le monde occidental.
Maxime Chaix :
Votre dernier livre, La Machine de guerre américaine, démontre notamment qu’une part importante des revenus narcotiques alimente le système bancaire global, dont les banques des États-Unis, créant une véritable « narconomie ». Dans cette perspective, que pensez-vous de l’affaire HSBC ?
Peter Dale Scott : Tout d’abord, le scandale du blanchiment d’argent par HSBC nous amène à penser que la manipulation des bénéfices narcotiques par cette banque aurait pu contribuer à financer le terrorisme — comme l’avait révélé une sous-commission du Sénat en juillet 2012 —. De plus, un nouveau rapport sénatorial a estimé que « chaque année, entre 300 milliards et 1 trillion de dollars d’origine criminelle sont blanchis par les banques à travers le monde, la moitié de ces fonds transitant par les banques états-uniennes ». Dans ce contexte, les autorités gouvernementales nous expliquent qu’HSBC ne sera pas démantelée car elle est trop importante dans l’architecture financière occidentale. Souvenez-vous qu’Antonio Maria Costa, le directeur de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), avait rapporté qu’en 2008, « les milliards de narcodollars ont empêché le système de sombrer au paroxysme de la crise [financière] globale. »
Ainsi, HSBC s’est entendue avec le département de la Justice pour payer une amende d’environ 1,92 milliards de dollars, ce qui évitera des poursuites pénales. Le gouvernement des États-Unis nous fait ainsi comprendre que personne ne sera condamné pour ces crimes car, comme je l’ai souligné précédemment, cette banque fait partie intégrante du système. C’est un aveu déterminant. En réalité, toutes les grandes banques ayant une importance systémique — pas seulement HSBC — ont admis avoir mis en place des filiales spécialement conçues pour blanchir l’argent sale (les
private banks). Certaines ont payé de lourdes amendes, qui sont habituellement bien moins importantes que les profits générés par le blanchiment d’argent. Et aussi longtemps que cette impunité sera maintenue, le système fonctionnera de cette manière. C’est un véritable scandale. En effet, songez à un individu lambda se faisant arrêter avec quelques grammes de cocaïne en poche. Il sera très probablement incarcéré, mais la banque HSBC pourrait avoir blanchi environ 7 milliards de dollars de revenus narcotiques grâce à sa filiale mexicaine sans que personne n’aille en prison. En réalité, la drogue est l’un des principaux éléments soutenant le dollar, d’où l’emploi de l’expression « narconomie ». Les trois premiers produits échangés dans le commerce international sont d’abord le pétrole, puis les armes et enfin les drogues. Ces trois éléments sont interconnectés, et ils alimentent les banques de la même manière. C’est pourquoi la majorité de l’argent des drogues est absorbée par le système bancaire global. Ainsi, dans
La Machine de guerre américaine, j’étudie comment une partie de ces revenus narcotiques finance certaines opérations clandestines états-uniennes, et j’en analyse les conséquences.
Maxime Chaix :
Il y a 10 ans, l’administration Bush lançait la guerre d’Irak, sans l’aval du Conseil de sécurité des Nations-Unies. Quel bilan tirez-vous de ce conflit, notamment au regard de ses coûts humains et financiers ?
Peter Dale Scott : Selon moi, il y a eu deux grands désastres dans la politique étrangère récente des États-Unis. Il s’agit de la guerre du Vietnam, qui n’était pas nécessaire, et de la guerre d’Irak, qui l’était encore moins. L’objectif affiché de cette guerre était d’instaurer la démocratie dans ce pays, ce qui était une véritable illusion. Il appartient au peuple irakien de déterminer s’il est dans une meilleure situation aujourd’hui qu’avant cette guerre, mais je doute qu’il réponde par l’affirmative s’il était consulté sur cette question.
Au regard des coûts humains et financiers de ce conflit, celui-ci fut un désastre, aussi bien pour l’Irak que pour les États-Unis. Toutefois, dans un documentaire qui lui est dédié, l’ancien vice-président Dick Cheney vient de déclarer qu’il referait la même chose « dans la minute ». Or, le
Financial Times a récemment estimé que les contractants avaient signé pour plus de 138 milliards de dollars de contrats avec le gouvernement des États-Unis, dans le cadre de la reconstruction de l’Irak. À elle seule l’entreprise KBR, une filiale d’Halliburton — dirigée par Dick Cheney avant qu’il ne devienne vice-président —, a signé pour au moins 39,5 milliards de dollars de contrats fédéraux depuis 2003. Rappelons également qu’à la fin de l’année 2000, un an avant le 11-Septembre, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont cosigné une étude importante élaborée par le PNAC (le groupe de pression néoconservateur appelé le Projet pour le Nouveau Siècle Américain). Intitulée
Reconstruire les Défenses de l’Amérique (
Rebuilding America’s Defenses), cette étude réclamait notamment une forte augmentation du budget de la Défense, l’éviction d’Irak de Saddam Hussein, et le maintien de troupes états-uniennes dans la région du golfe Persique même après la chute du dictateur irakien. Ainsi, en dépit des coûts humains et financiers de cette guerre, certaines entreprises privées ont massivement profité de ce conflit, comme je l’ai analysé dans
La Machine de guerre américaine. Enfin, au Proche-Orient, lorsque l’on observe les très fortes tensions entre les chiites, qui sont appuyés par l’Iran, et les sunnites soutenus par l’Arabie saoudite et le Qatar, il faut garder à l’esprit que la guerre d’Irak a eu un impact très déstabilisant dans cette région…
Maxime Chaix :
Justement, quel est votre point de vue sur la situation en Syrie, et sur les potentielles solutions à ce conflit ?
Peter Dale Scott : Au vu de la complexité de cette situation, il n’existe pas de réponse simple sur ce qui devrait être fait en Syrie, du moins au niveau local. Toutefois, en tant qu’ancien diplomate, je suis convaincu que nous ayons besoin d’un consensus entre les grandes puissances. La Russie continue d’insister sur la nécessité de s’en tenir aux accords de Genève. Ce n’est pas le cas des États-Unis, qui ont agi bien au-delà du mandat du Conseil de sécurité en Libye, et qui sont en train de rompre un potentiel consensus en Syrie. Ce n’est pas la marche à suivre car, à mon sens, un consensus international est nécessaire. Sinon, il se pourrait que la guerre par procuration entre chiites et sunnites au Proche-Orient finisse par attirer directement l’Arabie saoudite et l’Iran dans le conflit syrien. Il y aurait alors un risque de guerre entre les États-Unis et la Russie. La Première Guerre mondiale a éclaté de cette manière, ayant été déclenchée par un événement local en Bosnie. Et la Seconde Guerre mondiale a débuté avec une guerre par procuration en Espagne, qui opposait à distance la Russie et l’Allemagne. Nous devons et nous pouvons éviter la répétition d’une telle tragédie.
Maxime Chaix :
Mais ne pensez-vous pas qu’au contraire, les États-Unis cherchent aujourd’hui à s’entendre avec la Russie, essentiellement à travers la diplomatie de John Kerry ?
-

Peter Dale Scott : Pour vous répondre, permettez-moi de faire une analogie avec ce qu’il s’est déroulé en Afghanistan et en Asie centrale dans les années 1990, après le retrait soviétique. Aux États-Unis, le problème récurrent est qu’il est difficile de parvenir à un consensus au sein du gouvernement, car il existe une multitude d’agences ayant parfois des objectifs antagonistes. Il en résulte l’impossibilité d’obtenir une politique unifiée et cohérente, et c’est précisément ce que nous avons pu observer en Afghanistan en 1990. Le département d’État voulait impérativement parvenir à un accord avec la Russie, mais la CIA continuait de travailler avec ses alliés narcotiques et/ou jihadistes en Afghanistan, n’ayant pas l’intention de mettre fin à cette collaboration. Par conséquent, dans une certaine mesure, il existait une concurrence entre l’Agence et le département d’État en Afghanistan. À cette époque, Strobe Talbott — un très proche ami du président Clinton, dont il était un influent représentant personnel au sein du département d’État —, déclara avec justesse que les États-Unis devaient parvenir à un arrangement avec la Russie en Asie centrale, et non considérer cette région comme un « grand échiquier » où manipuler les événements à notre avantage (pour reprendre le concept de Zbigniew Brzezinski). Mais dans le même temps, la CIA et le Pentagone étaient en train de nouer des accords secrets avec l’Ouzbékistan, qui neutralisèrent totalement ce que Strobe Talbott était en train d’accomplir. Je doute qu’aujourd’hui, de telles divisions internes au sein de l’appareil diplomatique et sécuritaire des États-Unis aient disparu.
Dans tous les cas, depuis 1992, la doctrine Wolfowitz mise en œuvre à partir de 2001 par les néoconservateurs de l’administration Bush appelle à la domination globale et unilatérale des États-Unis. Parallèlement, des éléments plus modérés du département d’État tentent de négocier des solutions pacifiques aux différents conflits dans le cadre des Nations Unies. Cependant, il est impossible de négocier la paix tout en appelant à dominer le monde par la force militaire. Malheureusement, les faucons intransigeants l’emportent le plus souvent, pour la simple et bonne raison qu’ils bénéficient des budgets les plus élevés – ceux qui alimentent
La Machine de guerre américaine –. En effet, si vous parvenez à des compromis diplomatiques, ces faucons verront leurs budgets amoindris, ce qui explique pourquoi les pires solutions ont tendance à prévaloir dans la politique étrangère états-unienne. Et c’est précisément ce qui pourrait empêcher un consensus diplomatique entre les États-Unis et la Russie dans le conflit syrien.