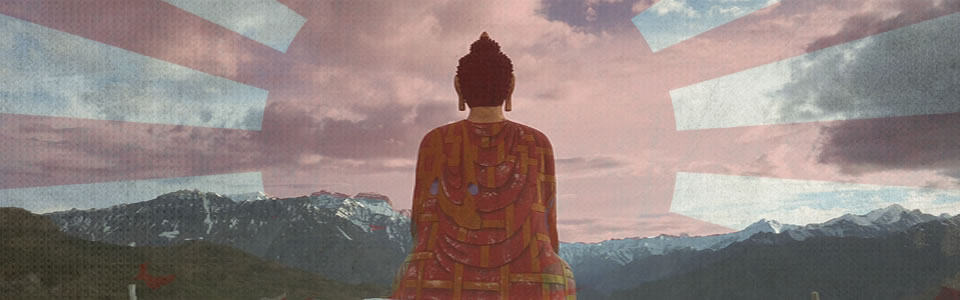A Montréal, la marijuana se vend à domicile. Une nuée de livreurs sillonne la ville au nez et à la barbe de la police, impuissante à enrayer le trafic. Alors que plusieurs États américains ont légalisé la consommation d'herbe, le gouvernement conservateur maintient le cap de la prohibition totale.
Midi pile dans le centre-ville de Montréal. Le quartier regorge d’employés, touristes et étudiants cherchant de quoi remplir leur pause déjeuner.
Un imposant 4x4 enjambe le trottoir. S'immobilise. La vitre descend sur un visage presque poupin aux yeux encore collés de sommeil. On songe à un jeune prodige du football américain ou à un lycéen nanti qui se rendrait en cours à contrecœur, et avec la voiture de papa. Mais non, Simon[1] commence sa journée, et il n’est pas levé depuis si longtemps, voilà tout.
«Bonjour. Montez derrière, on va avoir des passagers», lance-t-il avec une voix pleine d'assurance, sans rapport avec son physique d'adolescent.
A peine le temps de boucler sa ceinture que le véhicule se mêle à l'épaisse circulation de la mi-journée, direction Place des Arts, à deux pas de là, dans l’hyper-centre montréalais. Dans le flot des passants, Simon repère son premier rendez-vous. Du menton, il désigne un jeune homme qui fait les cent pas sur le trottoir: «Le voilà».
La suite ressemble à un rituel parfaitement huilé: apercevant le 4x4, le client s’approche et prend place sur le siège passager. C’est à peine s’il dit «bonjour» en tendant à Simon les 25 dollars qu’il chiffonnait dans son poing serré. Simon empoche l’argent d’une main tandis que l’autre, d’un geste vif, dépose un sachet sur les cuisses du client. Marijuana, 3,5 grammes.
Deux minutes plus tard et trois coins de rue plus loin. Cette fois, le client ne nous a pas vus arriver. Simon se signale d’un coup de klaxon sans s’émouvoir de la vingtaine d’yeux qui se tournent instantanément vers lui, dont ceux, délavés, d’un trentenaire que soutient un feu tricolore.
Reconnaissant le véhicule, ce dernier s’approche et le manège se répète, quasiment identique, si ce n’est la marchandise échangée. Du speed cette fois: deux peanuts, 15 dollars.
Sitôt servi, le client s'envoie les deux comprimés au fond de la gorge, bredouille un salut mal dégluti et sort du véhicule. La transaction a duré moins de trente secondes et le passager n'a pas même remarqué la présence, sur la banquette arrière, du journaliste qui l’observait.
«Pizzas»
Simon a 22 ans. Lorsqu’on lui demande ce qu’il fait dans la vie, il répond: «Livreur de pizzas.» A bien y regarder, le fonctionnement n’est pas si différent. Les clients se procurent le numéro d’un dealer, souvent grâce au bouche-à-oreille. Ce dernier possède un téléphone à usage strictement professionnel —certains se contentent d’un téléavertisseur ou bipeur— sur lequel il reçoit les adresses des clients, sans indications sur la nature ou la quantité du produit à livrer.
La plupart du temps, la livraison est assurée en moins de 45 minutes. Simon explique qu’ils sont deux à parcourir la ville pour son «boss». C’est son collègue qui reçoit les appels des clients et les répartit entre eux deux.
Mobile en main, il compose un numéro et son oreillette se met à grésiller une adresse qu'il recopie sur un bout de papier: la prochaine livraison aura lieu à domicile, à l’extrémité nord de la ville. Ce qui implique que la commande soit fort juteuse pour justifier les cinquante minutes de trajet aller-retour.
Arrivé sur les lieux, Simon stationne le 4x4 dans une contre-allée. Il extirpe un sac poubelle de sous son siège, y plonge la main et en sort quelques sachets d'herbe qu'il enfourne dans sa besace. Puis claque la portière pour reparaître moins de cinq minutes plus tard, avec l'air satisfait de celui qui vient de réaliser une bonne affaire.
Professionnel
Simon a tous les attributs d’un professionnel. Ses gestes sont rapides, précis, il travaille sans ostentation ni effets de manche et n’affiche pas l’arrogance de certains petits trafiquants. C’est un employé consciencieux, en somme. Et bien-sûr, il n’a aucun état d’âme.
Sur le trajet qui nous ramène au centre-ville, la conversation se délie et sa langue aussi. Lui qui était plutôt taiseux et distant jusqu’à présent passe au tutoiement, se raconte. Explique qu’il a fait ses armes à l’école secondaire, en vendant d'abord un joint, puis un gramme, puis sept, et ainsi de suite jusqu'à acheter une once (environ 28,5 grammes).
«Tu sais, quand t’as 14-15 ans pis que tu t’aperçois que tu peux faire de l’argent comme de l’eau juste en vendant du pot, c’est pas facile de résister», se justifie-t-il. D'abord circonscrits à son quartier – qu'il refusera de nommer – les petits trafics de Simon grandissent en même temps que lui jusqu'à lui permettre, une fois l'âge venu, de se payer le permis de conduire.
Il commence alors par travailler à son propre compte mais s’aperçoit que «c'est beaucoup de boulot, beaucoup de risques et en bout de ligne, pas beaucoup plus de cash». Et puis, tranche-t-il, «monter son business est un projet à long terme, alors que moi je fais ça pour payer mes études». Plus tard, oui, il aura une entreprise, mais légale celle-ci. Une entreprise de transports, assure-t-il.
Des salaires stupéfiants
Selon le commandant François Bleau, en charge des enquêtes multidisciplinaires pour le secteur Nord au Service de police de la ville de Montréal (SPVM), «il est impossible de chiffrer le nombre de dealers qui sévissent à Montréal, ces trafiquants à pagette (synonyme de téléavertisseur au Québec) ont suppléé puis supplanté les anciens dealers de rue qui tenaient boutique dans des appartements, des arrière-cours, ou des halls d’immeubles, ce qui les rendait plus visibles». Montréal n’est pas une exception, et on retrouve le phénomène dans d’autres villes nord-américaines comme New York.
François Bleau explique qu’au Québec la filière marijuana – dont la variété locale est éloquemment appelée Québec Gold par les initiés – est florissante et très lucrative, ce qui permet aux trafiquants d’employer des petites mains qu’ils rémunèrent assez largement. «Et devant les montants offerts, les candidats ne manquent pas!», déplore-t-il, en reconnaissant que souvent, lorsqu’un livreur est interpellé, un autre le remplace presque aussitôt.
Il faut dire que peu de jobs étudiants peuvent rivaliser avec les salaires offerts aux livreurs de drogue. Simon touche ainsi 25% sur tout ce qu'il vend:
«En général, ça m’donne 150 à 200 dollars par jour, pour six heures de travail.»
A raison de quatre jours par semaine, cela fait une moyenne mensuelle avoisinant les 2.800 dollars canadiens (environ 2.000 euros), évidemment net d'impôt. Au salaire minimum québécois, il faudrait travailler 70 heures par semaine pour prétendre à un tel montant. Et encore, avant impôt.
Un boss mystérieux
Simon a bien tenté de trouver un «job normal», comme les autres étudiants, employé de ménage, par exemple, mais l'expérience a fait long feu. Six mois exactement, qu’il résume d'une phrase:
«Tu travailles le même nombre d'heures, le boulot est deux fois plus dur, et t’es deux fois moins bien payé.»
Alors il décide de se remettre au service de son «boss».
Léger flottement lorsqu’on lui demande qui est ce fameux «boss». Il prétend le connaître à peine, un type de son quartier qu’il aurait rencontré par l’entremise de son frère. Pour qui travaille-t-il, où se fournit-il, a-t-il partie liée avec les organisations criminelles? «Je sais pas, lance-t-il sans convaincre. Je le vois presque jamais ce gars-là, je vais chez lui environ une fois par semaine, quand j’ai plus rien à vendre. Il me donne du stock, je lui donne son cash et that’s it!» Il affirme n’être membre d’aucun gang de rue et ne jamais avoir eu affaire à la mafia.
Le quasi-monopole du crime organisé
Pourtant, selon André Cédilot, ancien journaliste et co-auteur de Mafia Inc., grandeur et misère du clan sicilien, ouvrage de référence sur le crime organisé à Montréal, il ne fait aucun doute que Simon travaille de près ou de loin pour un gang de rue ou la mafia, peut-être sans le savoir:
«La grande majorité de la drogue qui est importée ou produite à Montréal l’est sous le contrôle du crime organisé. Lui seul possède non seulement les réseaux mais aussi les moyens humains et financiers nécessaires à une telle entreprise.»
L’approvisionnement, explique-t-il, est entièrement géré par la mafia sicilienne –sur le point de se faire détrôner par les Calabrais– et pour la revente, les chefs mafieux se partagent le territoire avec les gangs de rue, de sorte qu’aucun trafic ou presque n’échappe à son contrôle. Ensuite, chacun veille à ce qu’on ne vienne pas empiéter sur ses plates-bandes:
«Le maillage du territoire est tellement serré que seuls les très petits revendeurs indépendants parviennent à passer entre les mailles du filet.»
Attrape-moi si tu peux
Ce qui frappe surtout lorsque l’on passe quelques heures avec Simon, c’est le peu de cas qu’il semble faire de la présence policière. Pas une seule fois en plus de dix clients, il ne s’est montré inquiet ou sur ses gardes. Pas même lors de ses deux premières livraisons, en plein centre-ville et à l’heure de pointe.
«Au début, le risque était grisant, puis un peu apeurant et maintenant, il est devenu familier. Je prends ça relax, philosophe-t-il, il faut pas paniquer c’est le meilleur moyen d’attirer l’attention.» Des précautions particulières?
«Je ne m’attarde jamais trop longtemps au même endroit et quand je croise la police sur le lieu d’une livraison, je passe ma route et reviens plus tard.»
A l’entendre, la police n’est pour ainsi dire pas une menace. Et c’est tout juste s’il ne fanfaronne pas en racontant qu’il n’a été inquiété qu’une fois, «et encore, pour une infraction au code de la route».
Il ponctue son récit de «il paraît» et de «on m’a dit». On comprend qu’il ne s’est pas beaucoup renseigné sur la question lorsqu’il assène sans ambages que «de toute façon sans flagrant délit, ils ne peuvent rien faire!».
Mais si pour les agents de police, le flagrant délit est préférable avant de procéder à une interpellation ou à une fouille, il n’est pas pour autant indispensable. «Le code pénal indique que, pour intervenir, il nous faut un motif raisonnable de croire en une infraction criminelle, explique le sergent détective Nicodémo Milano, superviseur des stupéfiants pour la région Nord au SPVM. Alors on patrouille, on observe, on enquête et quand on a ce motif raisonnable, on intervient.» Son supérieur, le commandant Bleau, précise que «la lutte contre le trafic de stupéfiants représente 80% des interventions de [ses] hommes».
Outre les techniques classiques, d’enquête, de filature ou d’infiltration, il explique que les appels au centre Info-crime représentent une aide précieuse pour la police:
«Ce sont des citoyens importunés, des parents inquiets qui ont trouvé un peu d’herbe dans la veste de leur enfant. Des clients insatisfaits qui nous appellent pour dénoncer leur dealer, et parfois même des concurrents avides de récupérer un bout de territoire.»
Trafic à peine perturbé
Pourtant, malgré les efforts déployés par la police, le trafic de marijuana à Montréal est bel et bien un «secret de polichinelle», comme l’écrivait un journaliste québécois. Que ce soit au pied du Mont Royal —lieu touristique par excellence— ou aux abords des stations de métro, les sollicitations sont omniprésentes.
Si l’on trouve ça et là quelques interlocuteurs pour soupçonner la police de laxisme voire de corruption, la plupart des spécialistes interrogés expliquent l’incapacité des politiques publiques à enrayer le trafic par sa nature même, incontrôlable par essence. C’est le cas de Line Beauchesne, criminologue et professeure à l’université d’Ottawa, selon qui les livreurs de drogues sont «plus un symptôme qu’une cause». «Et quand bien même la police viendrait à bout de ce trafic, ajoute-t-elle, un brin défaitiste, le crime organisé trouverait d’autres réseaux pour écouler sa marchandise.»
André Cédilot, lui, trouve plus juste de parler de «tolérance» que de «laxisme». Il explique cette tolérance par le fait que d’une part, la police cherche plutôt à faire tomber les têtes de réseaux que les petites mains, et que d’autre part, elle est garante de l’ordre public. «Partant de là, sa mission est plutôt de réguler le trafic que de l’éradiquer», dit-il, citant le criminologue français Casamayor:
«La police ne réprime pas le crime, elle le contrôle.»
Laxisme?
Quant à son co-auteur André Noël, également journaliste à La Presse et spécialiste des questions de criminalité, il établit un parallèle entre le trafic de drogues et les escort girls:
«Tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que c’est interdit, mais la société laisse faire et la police aussi. Et de temps en temps, quand la situation devient hors de contrôle, on frappe un grand coup pour remettre de l’ordre.»
Lorsque l’on aborde avec lui la question du laxisme, le lieutenant Ian Lafrenière, porte-parole du SPVM, choisit lui l’ironie pour botter en touche:
«Si vous connaissez des gens qui nous trouvent laxistes, donnez-moi vite leur nom pour que je les ajoute à ma liste d’amis. D’habitude, on nous reproche plutôt d’être trop zélés.»
Puis, redevenant sérieux, il invoque les statistiques officielles, qui font état d'une augmentation de 7% des infractions relatives à la possession de cannabis entre 2010 et 2011 au Québec. Preuve selon Ian Lafrenière que la police ne chôme pas en matière de lutte contre les stupéfiants.
«Une guerre ingagnable»
Mais les anti-prohibitionnistes renvoient ces chiffres à la figure des pouvoirs publics, en les accusant de combattre les effets du problème plutôt que ses causes. La possession de cannabis a ainsi représenté en 2011 plus de la moitié (54%) des interpellations liées à la drogue, toutes substances confondues. Une situation qui s’explique, selon la police, par le fait que la marijuana est la drogue la plus consommée au Canada.
Le professeur Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en toxicomanie, reproche au gouvernement du très conservateur Stephen Harper de criminaliser à outrance la consommation de cannabis:
«L’intensification de l’activité policière en matière de lutte contre le cannabis a plus touché les possesseurs que les trafiquants. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen de lutter contre le trafic.»
Un constat que les chiffres semblent corroborer: si les infractions concernant la possession augmentent, les infractions liées au trafic, à la production ou à la distribution de cannabis ont baissé de 11% entre 2010 et 2011.
Il n'empêche, les anti-prohibitionnistes fulminent. Avec, au Canada comme ailleurs, toujours les mêmes arguments, ici dans la bouche de Jean-Sébastien Fallu:
«Il faut en finir avec cette guerre ingagnable qui, depuis cinquante ans, a coûté des milliards de dollars, des dizaines de milliers de vies et n’a pas réussi à rendre plus difficile l’accès aux drogues ni à ébranler les organisations criminelles. Qui, peu disposées à renoncer à cette manne financière, n’abandonneront jamais la partie.»
Alors, insiste-t-il, qu’une légalisation encadrée du cannabis, assortie d’une taxation, priverait les organisations criminelles de leurs principaux revenus, en même temps qu'elle remplirait les caisses de l’État.
Répression nerveuse
C'est la solution pour laquelle se sont prononcés les citoyens du Colorado et de l'Etat de Washington, aux Etats-Unis, en légalisant, par référendum, la consommation de cannabis et sa possession en petite quantité (moins d'une once). Or, le Canada s'est engagé dans la voie opposée, consolidant ainsi son statut de bastion conservateur en Amérique du Nord.
Le gouvernement de Stephen Harper a fait adopter en mars 2012 une loi omnibus –c’est-à-dire portant sur plusieurs sujets– en matière de justice et de sécurité. Son volet concernant les drogues instaure des peines planchers pour production de cannabis, même en petite quantité (au moins six mois d’emprisonnement pour qui cultiverait plus de cinq plants) et allonge les peines maximales, qui passent de 7 à 14 ans.
Là encore, les réactions ont été immédiates. Et là encore, les arguments se font écho d'un pays, d'un continent à l'autre. Au Canada, les contempteurs de cette loi prédisent une explosion de la population carcérale et ses corollaires, coût faramineux et encombrement du système judiciaire. Et pour cause, une étude émanant du ministère de la Justice a révélé qu'un régime prévoyant des peines minimales pourrait multiplier le nombre d'incarcérations pour production de drogue par cinq!
Au plan international, la très sérieuse Global Commission on Drug Policy tient peu ou prou le même discours. Dans un rapport de juin 2011, déjà, elle se déclarait favorable à une régulation contrôlée et encadrée du cannabis.
Le Canada pointé du doigt
Mais voilà que le 29 février 2012, quelques-uns de ses membres ont jugé la situation canadienne suffisamment grave pour s'adresser directement au premier ministre Harper et aux sénateurs, déclarant dans une lettre ouverte que le Canada s’engageait sur une voie qui s'est ailleurs révélée «destructrice, coûteuse et inefficace». Et les signataires de brandir l’exemple du voisin étasunien où, écrivent-ils, la politique de la guerre totale contre la drogue, conduisant à bâtir toujours plus de prisons, a échoué à atteindre ses objectifs. Mais en dépit de la fronde et de ces recommandations, Stephen Harper a tenu bon, fidèle en cela à ses promesses électorales.
Plus que tout autre chose, cet épisode aura prouvé l’impossibilité d’un débat serein entre les tenants d’une dépénalisation, qui demandent aux gouvernants d’agir en pragmatiques plutôt qu’en idéologues et ces derniers, qui se placent sur le terrain de la morale et taxent leurs détracteurs de laxisme et d’irresponsabilité.
Simon lui, n'entend pas ces controverses. Il se moque de la politique, même quand elle s'intéresse à son gagne-pain et ne sait pas même ce qu'il risque s'il se fait prendre. Il n'y pense pas, voilà tout. Pas plus qu'il ne pense aux dommages causés par son petit commerce:
«J’ai aucun problème de conscience parce que je force personne. Tant qu’il y aura des clients, il y aura des dealers, et quand ce sera plus moi ce sera un autre.»
18 heures, sa journée est finie. Il flatte dans sa paume la liasse de billets accumulés et calcule à combien s’élève le quart qui lui revient. En bon gestionnaire, il décompte le prix du carburant et de sa pause-déjeuner. Bénéfice net: 130 dollars pour 6 heures de travail. De quoi lui ôter tout scrupule.
Jérôme Houard
[1] Le prénom a été modifié
Source :
http://www.slate.fr/