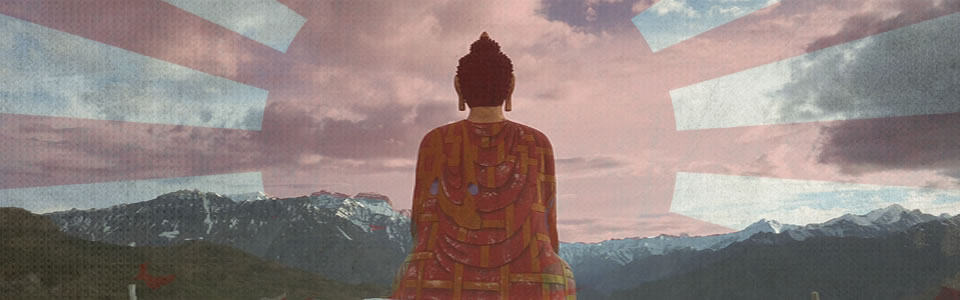- Etats-Unis: une pétition en faveur de l’autorisation du cannabis médicinal est présentée devant la cour fédérale
- Science/Homme: les effets des cannabinoïdes sont plus marqués lorsqu’ils sont pris avec un repas
- En bref
- Un coup d'œil sur le passé
Joseph Elford, l’avocat de l’association Americans for Safe Access a indiqué que la DEA avait choisi d’ignorer les preuves flagrantes des bienfaits du cannabis, en 2011, quand cette administration s’est opposée à l’assouplissement de la législation. La loi fédérale exige que la DEA prenne en compte ces données. Le gouvernement fédéral classe les drogues dans cinq catégories. Le contrôle le plus strict est au niveau I, qui comprend l’héroïne et le cannabis. La cocaïne est classée au niveau II et les médicaments prescrits par ordonnance sont dans les autres catégories où le contrôle est de moins en moins strict. Les critères du classement sont : le potentiel d’abus, la valeur médical et le risque de dépendance. L’association désire forcer la DEA en cour d’appel fédérale à tenir une audience sur la classification du cannabis. L’association estime que le cannabis devrait soit faire partie du niveau III ou un niveau inférieur.
Reuters du16 octobre 2012
Une étude clinique a été menée par la compagnie pharmaceutique GW Pharmaceuticals sur 12 personnes. Il a été prescrit à ces patients une dose simple de Sativex (4 vaporisations, soit 10.8 mg THC et 10 mg CBD) pendant une période de jeûne. 4 jours plus tard, il leur a été prescrit le même dosage au cours d’un repas.
Il a été établi que les concentrations sanguines de THC et de CBD sont maximales quand le Sativex est pris avec un repas, mais que toutefois, cette différence reste minime. Les sujets ont présenté des variations importantes des concentrations, principalement pour le THC. En état de jeûne, les concentrations maximales dans le plasma ont varié de 0.97 à 9.34 ng/ml. Suite à la prise d’un repas, elles ont atteint 2.81 à 14.91ng/ml. Sept des personnes ont présenté des concentrations en THC plus fortes quand les prises de Sativex et d’un repas étaient simultanées, alors que cinq des sujets ont présenté des concentrations de THC plus fortes quand la prise a été effectuée en période de jeûne. Pour tous les participants, il semblerait que la nourriture retarde le pic de concentration de 2 heures à 2 heures et demie, ce qui pourrait retarder le moment de l’effet maximum.
Stott CG, White L, Wright S, Wilbraham D, Guy GW. A phase I study to assess the effect of food on the single dose bioavailability of the THC/CBD oromucosal spray. EUR J Clin Pharmacol. 4 octobre 2012. [in press]
Science/Homme: dans une étude observationnelle, 4 patients sur 10 atteints de sclérose en plaques présentent une amélioration de leur condition grâce au Sativex
Une étude observationnelle a été réalisée en Allemagne, sur 300 patients à qui il a été administré du Sativex. La spasticité modérée à sévère a été réduite de 20% et plus sur 4 des 10 patients qui ne répondaient pas à la thérapie habituelle. Après trois mois, l’amélioration observée était de 30% ou plus. Ces résultats ont été présentés lors d’un congrès qui s’est tenu le 11 octobre à Lyon, France.
Press release by GW Pharmaceuticals of 12 October 2012
Science/Homme: le CBD inhibe les effets du THC sur le psychisme et les capacités cognitives
Lors d’une étude menée sur 48 sujets sains, à qui il a été administré 600 mg de CBD oralement, 210 minutes avant une infusion de 1,5 mg de THC, l’effet psychique a été moindre, la mémoire et les facultés cognitives meilleures que pour les participants à qui l’on a administré un placébo avant le THC.
The Biomedical Research Centre, Institute of Psychiatry, King's College London, UK.
Englund A, et al. J Psychopharmacol. 5 octobre 2012. [in press]
Hollande: la récente législation relative aux coffee-shops pourrait changer
Suite à l’élection parlementaire du 12 septembre 2012, la loi sur les coffee-shops vendant du cannabis pourrait changer. Les politiciens préparent une proposition pour en finir avec les divisions qu’a entrainé l’introduction des « wietpas », une carte de membre pour ces lieux de vente du cannabis. Il semblerait que l’application de la loi prévue pour janvier 2013, dans tout le pays, ne se fera pas. Le compromis mettrait fin à l’obligation des gérants de coffee-shops d’enregistrer leurs clients, et permettrait d’acheter des drogues douces dans tout le pays. Seuls les étrangers seraient tenus à l’écart de ce commerce. Les partis Labour et VVD sont actuellement en pour parlers quant à la formation du nouveau gouvernement.
DutchNews.nl du 18 octobre 2012
France: le ministre de l’Éducation réclame une discussion sur la légalisation du cannabis
Vincent Peillon, ministre de l’Éducation a indiqué lors d’une interview à la radio, qu’il était favorable à la légalisation du cannabis, et qu’il désirerait qu’une discussion soit instaurée. Il a ajouté que les résultats d’une politique répressive aux fins de lutte contre le trafic montrent que la répression n’est pas efficace. Le parti d’opposition a violemment réagi et a demandé une clarification de la part du Président François Hollande.
Le 15 octobre, le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a indiqué que la France n’avait pas l’intention de légaliser le cannabis.
UPI of 15 October 2012
Etats-Unis: la ville d’Oakland engage des poursuites contre le gouvernement fédéral qui a fait fermer les dispensaires de cannabis
La ville d’Oakland intente une action contre le gouvernement fédéral afin d’empêcher le Department of Justice de saisir les biens loués au plus grand dispensaire de cannabis médicinal du pays. « Ce procès concerne les droits légitimes des patients, » a indiqué l’avocate Barbara Parker, le 10 octobre, lors du dépôt de l’action.
New York Times of 11 October 2012.
Science/Animal: un inhibiteur de la synthèse d’un endocannabinoïde prometteur pour la lutte contre l’obésité
Un inhibiteur de la synthèse de l’endocannabinoïde 2-AG, appelé O-7460, a réduit les niveaux de 2-AG, et le poids des souris.
Endocannabinoid Research Group, C.N.R., Pozzuoli, Italy.
Bisogno T, et al. Br J Pharmacol. 2012 Oct 16. [in press]
Science/Animal: action synergétique du THC et de la morphine pour réduire la douleur
Une recherche menée sur des rats a montré que l’administration alternative d’un opioïde (morphine) et du cannabinoïde (THC) pourrait produire un effet analgésique plus durable et plus puissant que chacun des composants pris individuellement.
Department of Psychology, Washington State University Vancouver, USA.
Wilson-Poe AR, et al. Pharmacol Biochem Behav. 10 octobre 2012. [in press]
Science/Homme: Régularité à la thérapie des consommateurs du cannabis chez des patients positifs au HIV
Une étude menée sur 180 patients positifs au HIV, à qui il a été administré une thérapie antirétrovirale, a montré que ceux qui consommaient du cannabis étaient moins favorables à la thérapie, et ont ressenti des effets secondaires plus nombreux que ceux qui ne consommaient qu’occasionnellement ou pas du tout du cannabis.
National Center for PTSD, VA Palo Alto Health Care System, California, USA.
Bonn-Miller MO, et al. J Behav Med. 2012 Oct 7. [in press]
Science/Animal: le THC ne fait pas augmenter les effets de l’héroïne sur les singes
Lors d’une expérience réalisée sur des singes rhésus, l’auto-administration d’héroïne n’a pas augmenté quand l’héroïne est couplée avec du THC. Les auteurs ont conclu que ces résultats indiquent que le THC n’augmente pas de manière significative les effets de l’héroïne, ce qui amène à penser que l’activation simultanée des récepteurs par des agonistes opioïde et cannabinoïde (par exemple pour traiter la douleur) pourrait ne pas faire augmenter, voire même faire diminuer, le potentiel d’abus de chacune de ces substances. »
Departments of Pharmacology and Psychiatry, The University of Texas, San Antonio, USA.
Li JX, et al. Behav Pharmacol. 5 octobre 2012. [in press]
Science/Homme: la consommation de cannabis ne fait pas augmenter le risque de suicide
Une étude incluant 976 étudiants a montré qu’une forte consommation de cannabis n’est pas liée à un risque accru de suicide dans les deux années qui ont suivi, mais à un risque accru de dépression. Les participants ont été contactés en 2000/2001 et en 2002/2003.
Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University, Halifax, Canada.
Rasic D, et al. Drug Alcohol Depend. 4 oct 2012. [in press]
Il y a un an
Il y a deux ans
Read More